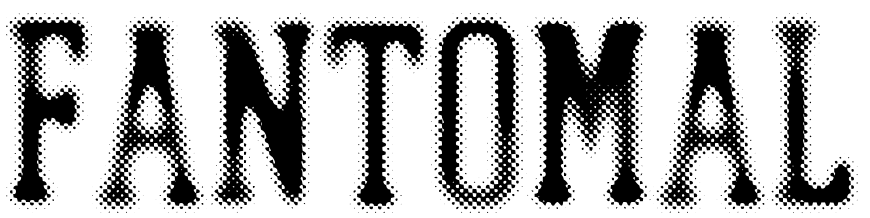Retranscription de la séance de questions-réponses qui a suivi l’avant-première du film Renoir de Chie Hayakawa, le 26 août 2025 au cinéma mk2 Bibliothèque à Paris. Traduction par Miyako Slocombe. Je recommande de voir le film avant de lire le texte. La première question du public est la mienne !
Modératrice : D’où est venue l’envie de faire Renoir ?
Chie Hayakawa : C’est à peu près depuis que j’avais l’âge de Fuki que je voulais faire des films. Il y avait plein de choses, des instants précis, des émotions précises que j’avais envie de mettre en scène au cinéma, et j’ai l’impression qu’avec ce film, je suis enfin parvenue à faire ce que j’avais envie de faire.
Modératrice : Est-ce que vous aviez déjà envie de faire ce film depuis que vous avez 11 ans ?
Chie Hayakawa : Non, pas exactement, j’avais plutôt de nombreuses bribes de scènes, que j’ai assemblées au moment de l’écriture du scénario de ce film, et c’est ça qui a donné ce que vous venez de voir.
Modératrice : Le film se passe en 1987, et j’ai un peu deux questions en une : déjà, pourquoi cette période-là de l’histoire du Japon, mais aussi, en 1987 vous aviez 11 ans comme Fuki, donc à quel point Fuki c’est vous ?
Chie Hayakawa : Effectivement, il y a le fait que j’avais 11 ans qui a orienté ce choix de placer le film à cette époque, mais c’est un film qui aurait pu se passer de nos jours, cependant il y avait ce concept de service de messagerie qui lui n’existait que dans les années 1980 et c’est surtout pour cette raison qu’il a été nécessaire de situer ce film à ce moment-là. Après, tout ce qui se passe dans le film, chaque épisode du récit, ce sont des fictions, ce ne sont pas du tout des choses qui me sont arrivées dans la réalité, en revanche dans la personnalité de Fuki, il y a beaucoup de parts de moi qui sont représentées. L’actrice Yui Suzuki, qui joue le rôle de Fuki, a eu aussi un rôle important car c’est une personne qui a énormément de charme, et qui a aussi réussi à insuffler sa propre personnalité, sa propre originalité au film.
Modératrice : À quel point le film est personnel ? Il est très différent de Plan 75, votre précédent long métrage.
Chie Hayakawa : On peut dire que c’est un film très personnel. Dans Plan 75, on était plutôt dans des problèmes de société, c’est un film qui est né de cela. Pour Renoir, j’avais envie d’une approche complètement différente, et d’être plus au niveau des sensations, de la sensibilité, et d’exprimer à travers un film des choses difficilement exprimables par les mots.
Modératrice : Plan 75 traitait, dans une sorte de fiction un peu futuriste, d’un plan pour que les personnes de 75 ans puissent décider de mettre fin à leur vie contre rémunération, dans un Japon du futur. On parlait donc déjà de mort, et là aussi on retrouve ce lien avec la mort et le deuil, avec l’histoire du père. C’était quelque chose de conscient, ou ça vous est un peu tombé dessus, « mince, mes deux films parlent de ça » ?
Chie Hayakawa : Je pense que j’en ai pris conscience une fois que le film a été fait. Après avoir réalisé Plan 75, je me suis demandée pourquoi cette thématique-là de la mort, du deuil, m’attirait autant, et je me suis rendue compte que moi-même, dans ma propre enfance, avec la vie que j’ai menée avec mon père malade, qui lui aussi a fait face à la mort, ça a eu une grande influence sur moi, cette perception de la mort, que j’ai mise en scène dans Plan 75. En ce sens-là, on peut donc dire effectivement qu’il y a un lien entre les deux films.
Modératrice : Ce qui est intéressant, c’est de voir que le film ne traite pas tant de la disparition que de l’entre-deux. C’est-à-dire que pendant tout le film, le père est encore là même si on le sait condamné, donc on n’est pas vraiment dans le deuil ni encore dans la vie, on est dans ce près deuil. Est-ce qu’on peut dire que c’est ce que raconte le film ?
Chie Hayakawa : C’est vrai que Fuki est un personnage qui est constamment proche de la mort, mais qui au début ne comprend pas que c’est quelque chose qui provoque forcément de la tristesse. Je crois que c’est un film qui parle de ça. Fuki ne comprend pas ce que c’est que le deuil au début et va petit à petit le découvrir. Pendant tout le film, elle est en train d’observer des gens qui pleurent, dès le début on a ces plans d’enfants qui pleurent, puis la scène des funérailles où ses amis sont en train de pleurer sa mort, on a aussi la mère qui crie de douleur à l’hôpital parce qu’elle a perdu son enfant. Au début, Fuki ne comprend pas la raison de ces larmes, mais à mesure que l’histoire va avancer, elle va le comprendre. Le film parle de cette transformation qui s’opère en elle.
Modératrice : J’ai une dernière question : pourquoi le titre Renoir ?
Chie Hayakawa : J’avais l’idée au départ de trouver un titre qui n’ait pas de lien direct avec l’histoire. Et je trouvais ça amusant d’avoir un contraste entre un film qui parle d’une jeune fille dans le Japon des années 1980, avec un titre qui ait le nom d’un peintre français. Lorsque le film a été présenté à Cannes, parmi les retours que j’ai eus, on m’a dit que les peintres impressionnistes accumulaient de la couleur pour former un tableau, et qu’à ce titre-là on pourrait établir une comparaison avec ce film qui accumule plein de petits épisodes, qui une fois cumulés forment une histoire. Dans ce sens-là, mon film a été comparé à un tableau de ce style. D’autre part, dans le Japon des années 1980, il y avait beaucoup de reproductions de tableaux occidentaux célèbres d’artistes comme Renoir, et c’était très à la mode d’avoir chez soi de telles reproductions, il y en avait aussi chez moi. Á l’époque, les Japonais admiraient beaucoup la culture occidentale et voulaient la rattraper. C’était une époque où ils faisaient beaucoup d’efforts pour être au niveau, alors qu’aujourd’hui, on trouve ça aussi étrange de décorer nos petites maisons japonaises de fausses peintures occidentales. C’est très révélateur des années 1980 au Japon.
Public : Ces derniers mois, en France, on a eu l’opportunité de découvrir la filmographie d’un réalisateur japonais qui s’appelle Shinji Somai, et en voyant Renoir, j’avais encore assez fraîches dans ma tête les images du film Déménagement. Je me demandais si ça avait pu être une inspiration, étant donné qu’on a aussi dans votre film une sorte de déménagement, une sorte de séparation, qu’on a une situation d’incommunicabilité entre parent et enfant, et même, vers la fin du film, une situation où l’enfant est un peu en errance seul, ce qu’on retrouve dans Déménagement avec ce passage onirique. Je voulais savoir si c’était un film auquel vous pensiez ou si c’est moi qui a vu ce lien comme j’ai vu le film récemment.
Chie Hayakawa : J’ai vu le film Déménagement de Shinji Somai quand j’étais au collège, et j’ai vraiment adoré. Il faisait partie de mes favoris. Je me disais qu’un jour, moi aussi j’aimerais réaliser ce genre de film, donc oui, c’est une grande influence de Renoir, qui est d’ailleurs parsemé de toutes sortes d’hommages. Jusqu’ici, Shinji Somai n’était pas un réalisateur beaucoup présenté à l’étranger, et c’est seulement ces dernières années que ses films commencent à y être projetés, notamment Déménagement. Par conséquent, je rencontre beaucoup de personnes qui l’ont vu, avant de voir mon film, et c’est quelque chose qui me rend très heureuse.
Public : Je n’ai pas vraiment de questions mais je voulais vous remercier pour les thèmes que vous avez abordés dans ce film. Je trouve qu’ils sont très importants, et qu’on ne les exploite peut-être pas assez. J’ai aussi beaucoup apprécié la fin du film que je trouve très positive, avec le retour de la complicité entre la petite fille et sa maman. Je travaille dans une maison de retraite et j’ai l’habitude de voir les accompagnants, les proches, qui sont en contact avec la mort et la refusent, souvent. Là, je trouve que c’était vraiment abordé de manière très délicate et très positive.
Chie Hayakawa : Merci beaucoup.
Public : Tout d’abord, je voulais vous dire que votre film a été un de mes préférés à Cannes. Á propos des sujets que vous y abordez, le deuil, la relation mère-fille, la pédophilie, je voulais savoir quelle était l’idée première, le message que vous vouliez transmettre, et si vous vouliez dès le départ explorer tout un panel de thématiques, en laissant la liberté au spectateur de se faire sa propre idée.
Chie Hayakawa : Je voulais faire un film dans lequel je puisse exprimer au maximum des sentiments que moi-même je ne comprends pas bien. Exprimer à travers le cinéma l’incompréhensible et l’inexplicable. Pour vous expliquer pourquoi, quand Plan 75 est sorti j’ai eu toutes sortes d’interviews, et je me rendais compte que j’arrivais très facilement à expliquer le film, et en fait je trouvais ça un peu ennuyeux. Je me suis dit que pour ce deuxième film, j’allais vraiment laisser mes impulsions parler d’elles-mêmes.
Public : J’ai une question sur la musique et l’ambiance sonore du film, que j’ai trouvé très touchante. Notamment lors des moments inconfortables où il y a des sons dissonants. Comment avez-vous travaillé ça, est-ce que c’était votre volonté quand vous avez commencé ce film ?
Chie Hayakawa : C’est le même compositeur que Plan 75, un compositeur français. On s’était mis d’accord dès le début sur le fait qu’on ne voulait pas utiliser la musique pour augmenter l’effet dramatique, mais qu’on allait uniquement l’utiliser dans le monde imaginaire de Fuki. Il y a aussi de nombreux sons qu’on entend tout au long du film. Il me semble que les enfants sont beaucoup plus sensibles à tous les bruits qui les entourent. Par rapport à la peur que ressent le père par rapport à sa mort imminente, j’ai voulu l’exprimer à travers le son, par exemple dans une scène où il se lave les mains, on entend très fort le bruit de l’eau qui coule et qui s’échappe via les canalisations, et le travail du son permettrait d’exprimer ce qu’il se passait émotionnellement dans l’esprit des personnages.
Modératrice : Le compositeur s’appelle Rémi Boubal.
Public : J’ai une question à propos de la gestion des acteurs. Comme vous dites que c’est un film très personnel, lors du casting, avez-vous eu des difficultés à trouver l’actrice principal, du fait que vous cherchiez peut-être un peu de vous en elle ? Et comment ça s’est passé sur le plateau pour gérer ces impulsions que vous aviez ?
Chie Hayakawa : Concernant le casting, je m’attendais à devoir auditionner plusieurs centaines d’actrices pour le rôle principal, mais il se trouve que Yui a été la première que j’ai auditionnée, et j’ai eu la chance de tout de suite la trouver. Je m’attendais à ce que ce soit assez difficile de diriger une jeune actrice, mais il se trouve que Yu Suzuki est une actrice extrêmement talentueuse, et je n’ai pratiquement pas eu à lui donner d’instructions. Je n’avais pas besoin de lui expliquer qu’elle devait avoir tel type d’expression à tel moment, ou que son personnage est censé ressentir ceci ou cela, je l’ai vraiment laissée libre d’interpréter comme elle le voulait le personnage de Fuki. En tant que réalisatrice, ça a été très facile de travailler avec elle. Du coup, il ne s’agissait pas tant que recréer mon enfance, que de rapprocher ce que j’étais enfant au personnage de Fuki.
Public : J’ai une question par rapport aux séquences imaginées par Fuki tout au long du film, notamment celle qui sert d’introduction. Est-ce que derrière ces séquences, outre le fait de rappeler que Fuki est une enfant, il y a aussi une volonté de l’installer comme une narratrice peut-être pas très fiable, et qu’on remette en question le reste des événements du film ? Si oui, est-ce que le fait de garder volontairement floue la limite entre ce qu’il se passe réellement et ce qui fait partie de l’imagine de Fuki a pu influencer le scénario ?
Chie Hayakawa : Dès l’étape du scénario, je tenais à ce que la frontière entre réel et imaginaire soit floue, cela parce que quand j’étais moi-même enfant, j’imaginais beaucoup de choses et j’avais beaucoup de fantasmes, et cette frontière entre ce qui était dans mon imagination et ce qui se produisait réellement était extrêmement floue.
Modératrice : Dans ce sens-là, j’ai une question sur le moment où Fuki fait un signe d’au revoir vers la fin du film. C’est un au revoir à qui ?
Chie Hayakawa : Différentes interprétations sont possibles. Ça peut être une scène issue d’un rêve de Fuki, mais peut-être aussi de sa mère. C’est peut-être aussi Fuki qui quitte sa famille pour partir dans le monde, et qui lui dit au revoir. Elle dit peut-être aussi au revoir à son père mort, elle dit peut-être à sa mère qu’elle sort de chez elle, ou c’est peut-être aussi la mère qui regarde sa fille. Je voulais que ce soit quelque chose d’ouvert à toute interprétation.